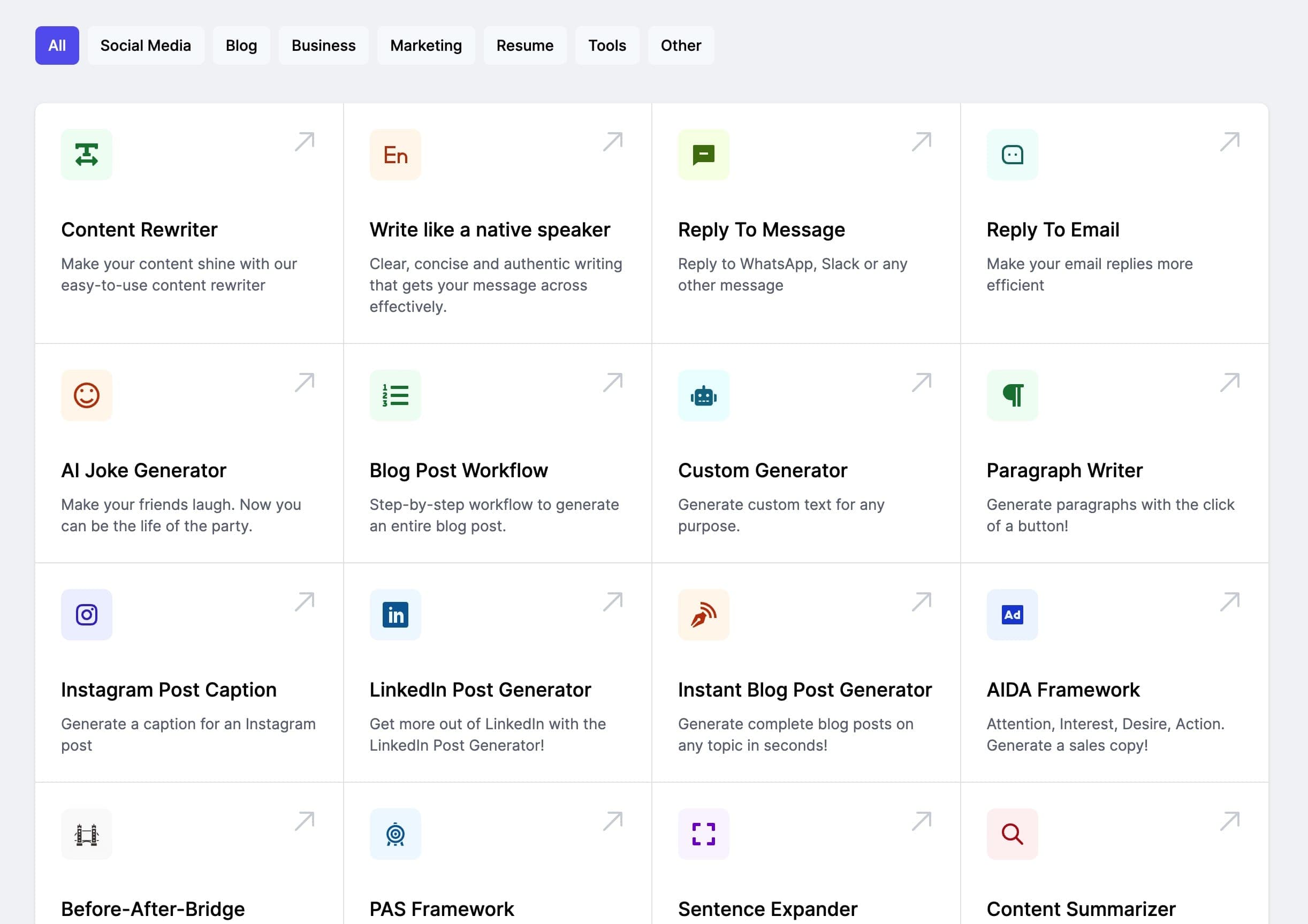Bouillonnante, foisonnante, originale, telle est la création contemporaine de la dernière décennie au Bénin. Elle procède de la maturation des différents acteurs de la scène artistique béninoise. En effet, l’ouverture culturelle du Bénin sur la scène internationale et notamment dans les arts de la scène et dans les arts plastiques est l’un des facteurs déterminant de cette extraordinaire vivacité que l’on observe dans la création contemporaine. De même, des structures d’accompagnement et de diffusion des arts ont fait leur apparition et contribuent à structurer un milieu qui, il n’y a pas longtemps encore, apparaissait comme une "nébuleuse chaotique" impossible à appréhender. En 2010 était lancée à Cotonou en terre béninoise une manifestation de grande envergure autour des arts visuels du Bénin. L’accueil enthousiaste qui entoura l’événement fut tel qu’il en résulta deux années plus tard une biennale des Arts Visuels : la Biennale Regard Bénin. Cela eu pour effet de dévoiler au monde une scène artistique béninoise bouillonnante et foisonnante. Dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey et Ouidah une plateforme artistique s’est progressivement mise en place alimentée par des réseaux culturels privés. Durant plusieurs décennies, le Centre Culturel Français avait été le seul espace de monstration. Depuis peu les espaces d’exposition, les ateliers se sont multipliés favorisant une extraordinaire production et une bien meilleure créativité. Plusieurs de ces structures d’accompagnement ont aujourd’hui pignon sur rue et favorisent la mise en place progressive d’un marché local de l’art. Par moment on observe une forme de gentrification au niveau des artistes eux-mêmes qui semblent évoluer dans un univers élitiste et bourgeois. Pour autant peut-on considérer que la scène artistique béninoise est favorable à l’émergence des plasticiens béninois ? Ces derniers se sont-ils embourgeoisés au point de renoncer à leur fonction de guides ? L’art béninois contemporain est-il à l’instar de "l’art nègre" une invention occidentale ? Comment les artistes béninois s’approprient-ils le concept d’art contemporain ? Le but du présent article est de lancer une réflexion sur l’art et la scène artistique contemporaine au Bénin. Dans une première partie à travers l’analyse des Centres d’expositions et des dynamiques générées par la mutation de l’artiste en entrepreneur, nous montrerons comment s’est façonnée cette scène artistique. Nous aborderons ensuite les tendances qui se dégagent dans la création contemporaine, les contradictions qui en résultent entre tradition et "modernité", et pour finir, nous nous s’attacherons à montrer les problèmes et les limites qu’induit cette ouverture à l’international.
Espaces et lieux de monstration La scène artistique béninoise s’est construite en grande partie en marge du système étatique en s’appuyant surtout sur des initiatives privées pour l’essentiel. L’un des premiers espaces de monstration de l’art contemporain du Bénin fut le Centre Culturel Français qui pendant une cinquantaine d’années a animé la ville culturelle cotonoise et promu de nombreux plasticiens au rang d’artistes planétaires. La présente décennie a vu la création d’une multitude de centres de promotion d’art érigés plus ou moins sur le modèle et la programmation du Centre Culturel Français. Certains de ces centres de promotion des arts sont nés à l’initiative des artistes qui se lancent de plus en plus dans l’entreprenariat culturel. L’essentiel de ces lieux culturels reste cependant concentré dans les espaces urbains tels que Cotonou, Porto-Novo Ouidah et Abomey-Calavi. Un répertoire réalisé en 2013 par l’Association Béninoise des Arts Plastiques (ABAP-FOUR P) dénombre 30 espaces de promotion et de diffusion des arts répartis de façon très inégale dans tout le pays comme le montrent le tableau et le graphe ci-dessous. La lecture de l’illustration montre la place écrasante du département du Littoral en ce qui concerne la création des centres de promotion et de diffusion des arts plastiques. Des départements tels que l’Alibori, la Donga, le Plateau ou encore le Couffo sont absentes même si ces départements connaissent une certaine production artistique. La ville de Cotonou à elle seule regroupe 60% des centres et environ 85% des activités liées aux vernissages d’expositions. On note toutefois à Cotonou une concentration de ces espaces de monstration dans des zones assez faciles d’accès et relativement fréquentée par une certaine élite. Ainsi, tandis qu’à Cotonou, des espaces tels que la Fondation Zinsou, l’Espace Tchif, Artisttik Afrika, l’espace ABC, la Médiathèque des Diasporas, Laboratorio ou encore Kültürforum Süd-Nord pour ne citer que quelques-uns ont aujourd’hui pignon sur rue et se partagent l’actualité culturelle, à Porto-Novo le centre culturel et touristique Ouadada, le Jardin des Plantes et de la Nature essaient de dynamiser des activités culturelles au ralenti. A Abomey on compte l’Espace Unik de Dominique Zinkpè et à Ouidah vient d’être créé un Musée d’art contemporain par la Fondation Zinsou. Ces espaces de monstration de l’art contemporain qui ne sont pas les seuls, mais semblent occuper de plus en plus une place importante sur la scène artistique béninoise favorise l’éclosion production plastique variée. Le nombre d’artistes et leur répartition confirme de degré d’importance des différents centres de promotion. Ainsi selon le répertoire des artistes du Bénin on dénombrerait environ 183 plasticiens en activité sur toute l’étendue du territoire béninois. Pour cette fois, tous les départements sont concernés comme l’illustre le tableau ci-dessous : Cette multiplicité des artistes dans une mégapole comme Cotonou n’est pas sans impact sur le développement des centres de promotion dont certains comme nous l’avions évoqué plus haut ont été créées par des plasticiens eux-mêmes.
Artiste et entrepreneur La problématique de l’artiste porteur/initiateur de projet est relativement récente. Elle apparaît dans un contexte de désengagement progressif de l’État des questions culturelles, obligeant ainsi l’artiste à se substituer à l’instance étatique. De nombreux centres de promotion des arts, des espaces culturels sont nés à l’initiative des artistes qui se lancent de plus en plus dans l’entreprenariat culturel. L’artiste africain ne se contente plus du rôle traditionnel qui était le sien et qui le réduisait à n’être qu’un porte-parole dans le meilleur des cas, sinon un fou dont on s’accommode des excentricités. Cette incursion des artistes dans le milieu des initiatives de projets en a fait des promoteurs culturels soucieux de la formalisation de leur métier. Elle a cependant davantage complexifié les rapports existants dans le milieu de la culture. Car, selon la tradition populaire au Bénin, l’artiste était un être à la fois béni et maudit des dieux et qui vivait en marge de la société. Aziza le génie du panthéon du Bénin méridional auquel l’on attribue l’inspiration des artistes serait l’esprit à l’origine de cette bénédiction empreinte de malédiction. L’artiste marqué du sceau d’Aziza, devient un être qui se situe aux frontières du monde des hommes et de celui des dieux. La bénédiction de pénétrer le monde des dieux s’accompagne inévitablement et inéluctablement de la malédiction d’être totalement incompris dans celui des hommes. De tels artistes ne regardent pas vers le monde moderne, mais en direction d'un monde perdu ou en passe d'être perdu. Ils deviennent les guides d'une nouvelle lecture de l'histoire africaine ; ceux que Jean-Loup Anselme (2001) nomme prophètes et Jean-Loup Pivin (2001) les artistes messagers. Aujourd’hui pourtant, l’artiste a réussi à s’affranchir peu ou prou de l’influence écrasante d’Aziza. Ce faisant, il s’est cependant coupé de son public lequel ne reconnaît plus en lui le messager des dieux. L’artiste s’est tout simplement embourgeoisé. Provocateur omniprésent, il fait partie, d’après Nathalie Heinich (2005), de la nouvelle élite aristocratique. Ils sont en effet un certain nombre à ne plus se contenter de créer dans la solitude de leurs ateliers. L’artiste est promoteur culturel, directeur d’un espace culturel dans lequel il initie ses pairs plus jeunes ou des enfants à qui il rêve de transmettre son amour de l’art. Ainsi naissent des espaces comme l’espace Tchif de Francis Tchiakpè à Cotonou au Bénin, Unik de Dominique Zinkpè à Abomey. Faut-il s’inquiéter que cette tendance se généralise ? Doit-on craindre une baisse de la productivité et de la créativité de l’artiste ? Ou, au contraire, faut-il y voir la possibilité pour l’artiste de s’offrir une visibilité plus grande et un moyen plus fiable d’assurer sa propre promotion ? La plupart des artistes sont conscients des contraintes qu’impose cette nouvelle situation. L’administration d’un centre implique en effet de trouver les investissements nécessaires à son fonctionnement. Afin de concilier la recherche de financement et son propre travail, l’artiste développe ses idées personnelles en les incluant dans des projets de plus grande envergure, à l’échelle de son espace culturel. Cette double approche d’un projet personnel qui se déploie à l’intérieur d’un autre plus vaste a l’avantage de permettre à l’artiste de s’ouvrir aux démarches artistiques de ses pairs et à d’autres projets culturels. Un grand nombre des espaces culturels administrés par les artistes ne se contentent pas de montrer seulement des expositions d’art, mais organisent également des concerts de musique, des représentations théâtrales, des projections de films, des spectacles de danse, etc. L’artiste, n’est donc plus le personnage solitaire et marginal que la société avait créé. Il s’est lui-même inventé un nouveau statut, celui d’un être qui veut promouvoir la culture sous toutes ses formes. Ce nouveau statut lui permet, au contact des autres formes d’art, d’explorer des champs plus vastes et d’en faire des sources d’inspiration nouvelles. Cependant, aussi grisante soit-elle, cette expérience, qui donne à l’artiste la sensation d’être maître de son destin, pourrait se révéler désastreuse s’il n’y prenait garde. La gestion d’un espace culturel pour l’artiste est une irruption dans le quotidien qui l’oblige à investir une partie de son énergie dans des questions triviales qui pourraient annihiler sa créativité. Certains artistes comme Dominique Zinkpè l’ont bien compris et préfèrent confier l’administration de leur espace à un spécialiste, tandis qu’eux continuent de se consacrer à leur art. L’implication des plasticiens dans la gestion de la promotion des arts et la multiplication des centres de diffusion ont contribué de façon sensible à donner plus de visibilité à la scène artistique béninoise qui a voulu en 2012-2013 lors de la Biennale Regard Bénin rivaliser avec une autre plateforme pourtant internationalement confirmée telle que Dak’art. Quoiqu’il en soit, il faut aujourd’hui compter avec l’artiste porteur de projets. Et cette nouvelle dimension de l’artiste introduit de nouvelles perspectives et interroge une nouvelle approche de l’art africain contemporain.
Regard sur la création contemporaine du Bénin La création contemporaine au Bénin est marquée par quelques personnalités de renom. Au nombre de ceux-ci, Romuald Hazoumè, certainement le plus médiatique et le plus frondeur des plasticiens fait pourtant office de porte-étendard de l’art contemporain béninois. Son aventure artistique ne commencera véritablement qu’à la fin des années 80 lorsqu’en 1989, il expose au Centre Culturel Français de Cotonou au Bénin et au Centre Culturel Franco-Nigérien de Niamey au Niger son fameux concept de « masques bidons ». Les plasticiens qui émergent dans la foulée connaissent des fortunes diverses et certains réussissent à se frayer un chemin sur la scène et le marché international de l’art. Georges Adéagbo, Dominique Zinkpè, Tchif, Gérard Quenum, Charly d’Almeida y sont assurément parvenus. Le premier est considéré comme l’un des précurseurs de l’installation et l’une des références de ce type de médium au Bénin ; les deux suivants font partie de ce que l’on peut nommer les "artistes entrepreneurs", créateurs d’espaces et initiateurs de projets. Leurs centres respectifs, Unik et Espace Tchif accueillent une jeune génération d’artistes extrêmement talentueux et créatifs. La nouvelle génération à l’instar de l’ancienne est constituée de plasticiens pour la plupart autodidactes. Ce qui est loin de constituer un obstacle à leur expression artistique. Les jeunes artistes se sont construits à force de travail régulier et constant. La moyenne d’âge se situe autour de la trentaine et ils ont pour la majorité au moins une exposition individuelle à leur actif en plus des différentes expositions collectives auxquelles ils sont assez souvent associés. Cette relative possibilité d’exposition pour ces plasticiens est la conséquence de l’évolution de la scène béninoise et de la création de réseaux artistiques dont les artistes en sont eux-mêmes en grande partie les animateurs. Un autre corollaire de l’ouverture de la scène béninoise concerne la multiplication des workshops entre artistes. Bien entendu le résultat de ces pratiques touche aux médiums d’expression artistique eux-mêmes. Ainsi la peinture et la sculpture ne sont plus les seuls médiums majeurs. D’autres techniques ont fait leur apparition et les artistes se les sont appropriés. Il en résulte au sein de cette génération une certaine polyvalence dans l’usage des médiums, et certains des artistes passent de l’un à l’autre sans la moindre difficulté. L’installation réputée pourtant difficile est un mode d’expression qui se répand de plus en plus dans le milieu tout comme la performance que certains artistes (Kiffouly, Laudamus Sègbo, Rafiy Okéfolahan…) ont intégré dans leurs pratiques. La vidéo et la photographie sont cependant encore peu pratiquées. La cause de cette pratique peu répandue est liée aux matériels plus importants que nécessitent ces deux techniques et dont disposent très peu de plasticiens. Pour pratiquer la photographie par exemple l’artiste a besoin d’un matériel important. Il est vrai que la diffusion de la photographie est aujourd’hui mondiale, et que, presque tout le monde peut éventuellement « prendre une photo », mais la photographie comme art est sujette à certains principes que bien peu de personnes maîtrisent. Pour ceux qui veulent continuer la photographie argentique en utilisant l’appareil reflex supplanté par l’ère du numérique, il faut pouvoir compter sur un bon studio pour développer ses négatifs, à défaut de disposer soit même d’une chambre noire et du matériel adéquat. Il faut donc dépenser une petite fortune pour les passionnés. La seconde option qui favorise les appareils numériques fait l’adhésion de la plupart des artistes. Le problème au départ est d’avoir suffisamment d’argent pour acquérir un appareil numérique.